Le président de l’Assemblée nationale a accepté de prendre la tête du ministère de l’Ecologie, vacante depuis la démission de Nicolas Hulot. Ce politique va très vite devoir faire ses preuves, vu les nombreux dossiers en suspens.
Du Palais Bourbon à l’Hôtel de Roquelaure, il n’y a qu’un pas que François de Rugy va allégrement franchir. Le couple exécutif lui a en effet proposé de prendre la tête du ministère de l’Ecologie dont la place était vacante depuis la démission surprise de Nicolas Hulot le 28 août. Ce que l’intéressé a accepté, d’autant que l’Elysée commençait à lui reprocher de ne pas assez tenir ses troupes à la tête de l’Assemblée nationale.
François de Rugy a exercé plusieurs mandats locaux dans le département de la Loire-Atlantique depuis 2011, dont le poste d’adjoint au maire de Nantes. Il est député de ce département depuis 2007. Avant d’accéder au perchoir, il a été deux fois co-président du groupe écologiste de l’Assemblée nationale, puis vice-président de l’Assemblée.
Il a débuté son engagement politique en 1991 dans le mouvement de Brice Lalonde, Génération écologie, avant de rejoindre Les Verts en 1997, puis Europe Ecologie – Les Verts en 2010, qu’il quittera en 2015 en critiquant la dérive gauchiste de cette formation. Il créera alors le Parti écologiste, rejoindra le groupe socialiste de l’Assemblée en 2016 avant de rejoindre le groupe La République en marche en 2017. Une évolution politique qui lui vaut une solide inimitié de la part de certains écologiste historiques.
Candidat à la primaire de la gauche pour les élections présidentielles, il n’avait obtenu que 3,88% des voix. Reniant sa promesse de soutenir le candidat sorti vainqueur de cette consultation, Benoît Hamon, il avait rejoint les troupes d’Emmanuel Macron, se retrouvant dans la majorité présidentielle après l’élection de ce dernier.
Le 28 août, au moment de la démission de Nicolas Hulot, il avait salué « son action (…) pour enclencher des transformations écologiques profondes« . « Plus que jamais, ajoutait-il, celles-ci doivent être accomplies avec engagement, persévérance et détermination« . Le voici maintenant à point d’oeuvre pour appliquer cette feuille de route.
De nombreux dossiers à concrétiser
Le nouveau ministre de la Transition écologique et solidaire trouvera sur son bureau une pile de dossiers délicats. La politique énergétique (PPE) figure en bonne place parmi ceux-ci et constitue sans conteste le sujet brûlant des six prochains mois. Les documents sont annoncés pour octobre. Le sujet est protéiforme, mais quelques points fixent les crispations. C’est le cas en particulier du nucléaire. Nicolas Hulot plaidait pour un calendrier de fermeture assorti d’une liste de réacteurs et s’opposait à de nouveaux EPR. L’exact opposé de ce que souhaite EDF. Bien sûr, la trajectoire de développement des renouvelables constituera un autre morceau de choix de la PPE. Il faudra notamment arbitrer entre les doléances du solaire, qui a les faveurs d’EDF et de Total, de l’éolien, objet d’une puissante contestation, des filières émergentes (énergies marines renouvelables), ou encore du gaz vert.
Pour autant, les autres grands volets de la politique environnementale sont loin d’être réglés. Pour l’instant, le gouvernement s’est contenté d’annoncer de grandes orientations. Le plus dur reste à faire : traduire en actes la multitude d’annonces inscrites dans les nombreux plans adoptés depuis un an… Le nouveau ministre devra ainsi mettre en œuvre le plan de rénovation énergétique des bâtiments, les 50 mesures de la feuille de route sur l’économie circulaire (Frec), le plan biodiversité.
Et tous les axes de travail n’ont pas encore été fixés. En matière de transport, on attend encore le projet de loi sur les mobilités et la planification des infrastructures de transports. Le dossier de l’eau est lui aussi à mi-chemin : le ministre devra appliquer les mesures du premier volet des assises de l’eau et piloter le second volet consacré à l’épineuse question de l’adaptation des territoires et des acteurs économiques à l’impact des changements climatiques sur la ressource en eau.
Quelle priorité budgétaire ?
Reste le nerf de la guerre : le financement des politiques environnementales et les sujets fiscaux associés. Le budget accordé à la politique environnementale devrait progresser. Reste à savoir de quelle manière se matérialisera cette « priorité ».
Plus globalement, les débats sur la fiscalité écologique sont loin d’être clos. Nicolas Hulot avait relancé en février des travaux pour sortir des mesures au « coup par coup » et ouvrir la voie à une « fiscalité comportementale » capable de changer les habitudes plutôt que de générer de nouvelles ressources. Son successeur va-t-il poursuivre la dynamique ?
Source: actu-environnement.com
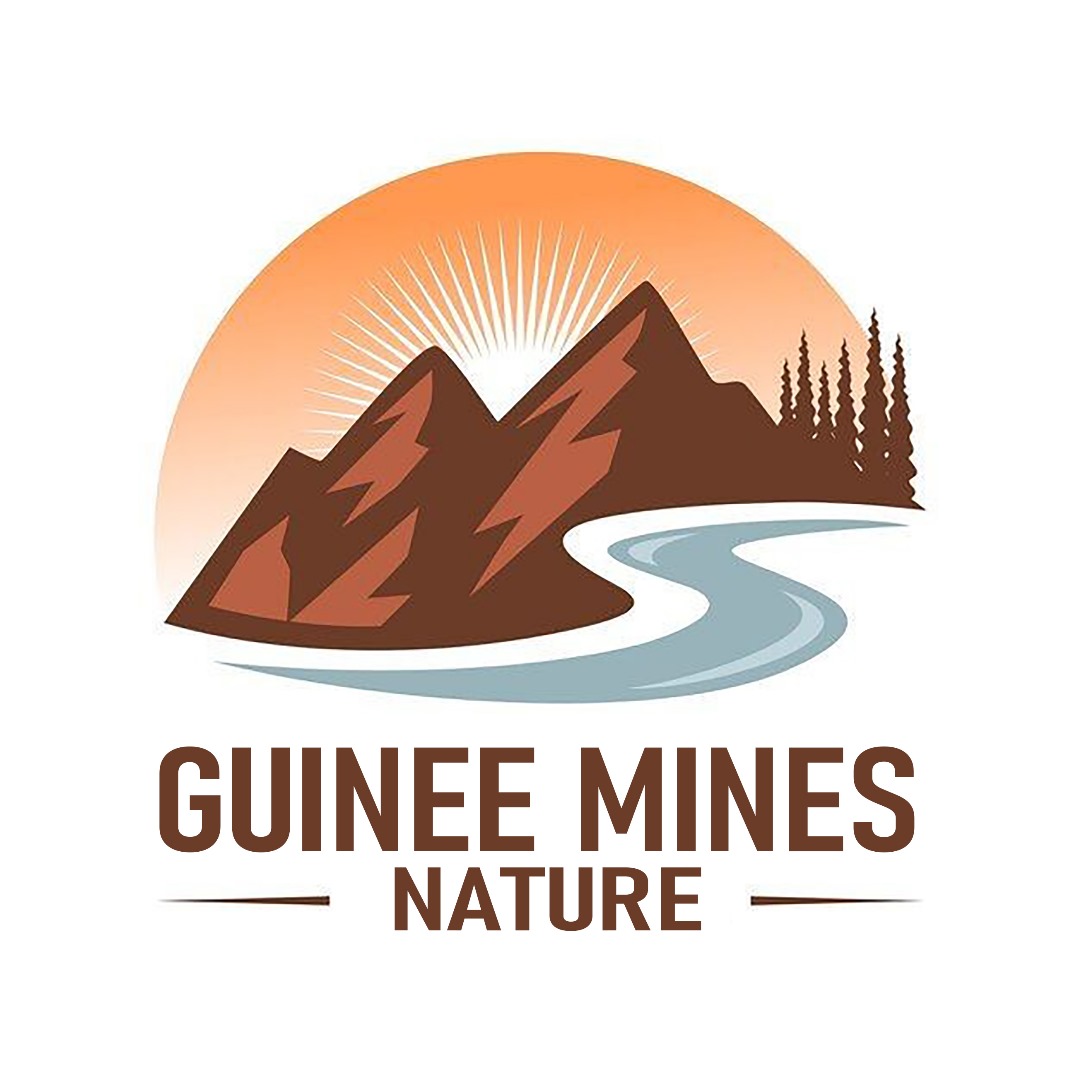














![𝐀𝐏𝐏𝐄𝐋 À 𝐂𝐀𝐍𝐃𝐈𝐃𝐀𝐓𝐔𝐑𝐄 -𝐒𝐀𝐍𝐓É 𝐄𝐓 𝐒É𝐂𝐔𝐑𝐈𝐓É 𝐀𝐔 𝐓𝐑𝐀𝐕𝐀𝐈𝐋 [𝐌𝐓𝐅𝐏-𝐈𝐍𝐅𝐏-𝐇𝐒𝐄𝐂]](http://guineeminesnature.com/wp-content/uploads/2025/01/Screenshot_20250101_163633_Android-System-100x70.jpg)




